|
|

mars 2007
piano à quatre mains
avec Caroline LATTANZI
et Alberto FRKA
| |

|
|
| |
Alberto FRKA
obtient son diplôme de fin d’études au conservatoire de Dubrovnik et
remporte de nombreux prix aux concours nationaux dans son pays. Il se
produit très souvent en soliste ou avec orchestre. En 1980, il intègre
la Schola Cantorum et l’Ecole Normale de Musique de Paris dans la classe
de Monique Mercier. Il se perfectionne ensuite avec Konstantin Boghino
ou encore Christopher Hoodgewood. Il a donné de nombreux récitals à
Paris, en Croatie, en Italie et aux Etats Unis.
Caroline LATTANZI a reçu le prix de la Virtuosité de la Schola Cantorum.
Elle a suivi des masters classes avec Gaby Casadesus (diffusée sur
France Musique), Jacques Parrenin ou encore Jay Gottlieb. Elle se
spécialise en musique de chambre (duo avec violoncelle, quatuor avec
piano). Elle sera membre du comité directeur des Concours UFAM de 1999 à
2003. Elle est actuellement professeur de piano à la Schola Cantorum.
Ils forment leur duo à 4
mains en 1991. Après seulement un an d’existence, le duo remporte le 1er
prix au Concours Musical de France, le 1er prix au Concours UFAM de
musique de chambre, le 3ème prix au Concorso Europeo de la Citta de
Moncalieri (Italie). En 1993, le 2ème prix aux Clés d’Or du Piano, le
2ème prix au Grand Concours National de piano
On a pu les écouter à
l’occasion d’enregistrements réalisés sur Arte et la chaîne musicale
Mezzo
Ils jouent
régulièrement à Paris, au Moulin d’Andé (2005), en Croatie (2003 – 2004) |
|
Caroline

|
|
 Alberto
Alberto |
|
|
| |
Fantaisie en fa mineur de
Schubert
La palme de la plus belle
pièce pour quatre mains de Schubert, et peut-être même de tout le
répertoire, revient à la Fantaisie en fa mineur. Composée entre
janvier et avril 1828, elle coûta à Schubert beaucoup d'efforts. La
dédicataire de l'œuvre était Caroline Esterhazy, la fille du comte, que
Schubert aimait depuis déjà plusieurs années ; amour impossible, bien
sûr, entre le jeune compositeur peu fortuné et la jeune fille issue de
la noblesse. Dès lors, difficile de ne pas voir dans cette pièce la
recherche symbolique et intime d'une union que Schubert savait sans
espoir dans la réalité. |
 |
|
| |
Danses hongroises de
Brahms
L'intérêt du
musicien pour la musique tzigane
fut très précoce : dès l'âge de dix-neuf ans, il accompagna le
violoniste hongrois Eduard
Reményi à travers l'Allemagne, qui l'initia à la musique de son pays.
Au nombre de 21,
elles furent composées sur plusieurs années : les six premières furent
proposées dès 1867 à un
éditeur, qui les refusa. Les dix premières parurent en
1869 dans leur version pour
piano à quatre mains. Les
dernières ont été éditées en 1880.
Elles ne comportent
pas de numéro d'opus, le compositeur ne les considérant pas comme des
œuvres originales, mais de simples adaptations d'œuvres de
musique traditionnelle. Il
semble cependant que les thèmes des onzième, quatorzième et seizième
soient totalement originaux. |
 |
|
| |
Rhapsody in blue de
Gershwin
Après le succès d'un
concert expérimental jazz-classique de la chanteuse canadienne
Eva Gauthier
au Aeolian Hall de
New-York le premier novembre 1923,
le chef d'orchestre Paul Whiteman
décida de se risquer dans un projet plus ambitieux.[]
Il commanda alors à Gershwin un
concerto pour présenter lors d'un concert jazz au Aeolian Hall en
février 1924. Gershwin n'était pas trop enthousiaste à l'idée de cette
nouvelle pièce.
Le 4 janvier, le
frère de George Gershwin, Ira
Gershwin lut dans le New York Tribune un article annonçant
que "George Gershwin travaillait à un concerto jazz". Mis au courant,
Gershwin décida finalement de composer la pièce.
Comme il ne restait
plus que cinq semaines avant le concert, Gershwin se mit rapidement au
travail, et c'est dans un train de
Boston que les idées pour la Rhapsody in Blue lui sont
venues.
Il se mit au travail
le 7 janvier, comme indiqué sur le manuscrit pour deux pianos.
[ ]La composition fut
achevée en quelques semaines et Gershwin demanda à Ferde Grofé de faire
les arrangements pour orchestre. Les
orchestrations furent finies le 4 février, seulement huit jours
avant la première.
L'orchestre de
Whiteman était augmenté d'une section de cordes, avec George Gershwin au
piano. Gershwin improvisa les solos de piano. Comme il n'écrivit la
partition de piano qu'après le concert, nous ne savons pas à quoi
ressemblait la Rhapsody originale |

|
|
| |
Epigraphes antiques de
Debussy
Plus encore que les
romantiques Debussy marque une rupture avec la forme classique. Ses
compositions se distinguent par une construction mélodique librement
inspirée des musiques orientales (recours à la
gamme pentatonique, à de
nombreuses altérations). Les thèmes sont épars, dissipés, les recherches
harmoniques audacieuses, les nuances délicates et les rythmes subtils.
Ses œuvres sont
avant tout sensorielles, elles visent à faire ressentir à l'auditeur des
sensations particulières en traduisant en musique des images et des
impressions bien précises. En cela, les titres évocateurs de ses pièces
en sont un bon exemple : Des pas sur la neige, La fille aux
cheveux de lin, Reflet dans l'eau, La cathédrale engloutie,
etc. Il subtilise de cette manière les couleurs aux notes ... Ainsi,
même s'il est difficile de le rattacher à un courant artistique, on le
qualifie généralement d'« impressionniste », étiquette qu'il n'a
lui-même jamais revendiquée et plutôt démentie.
De par ses
innovations, Debussy est souvent considéré comme étant à la base de la
musique moderne et contemporaine. On ne peut, malgré tout, qu'être
surpris par le fait qu'un compositeur d'une telle importance dans
l'histoire de la musique n'ait jamais fait « école » et qu'on ne peut
lui attribuer de véritable disciple. Les musicologues versés dans le
cinéma auront néanmoins l'occasion de mesurer l'influence considérable
de son art sur la musique « hollywoodienne », phénomène encore
persistant au travers de productions récentes.
Debussy publia en
1915 les Six Épigraphes antiques pour piano à quatre mains
(ainsi qu’une version à deux mains) qu’il avait écrits à partir de
motifs d’une musique de scène composée 15 ans plus tôt pour accompagner
la récitation des Chansons de Bilitis de son ami Pierre Louÿs,
partition qu’il ne faut pas confondre avec les trois mélodies qui
portent le même titre. |
 |
|
| |
Rapsodie Espagnole de
Ravel
La Rapsodie
espagnole de Maurice Ravel fut composée en 1907 Il s'agit de la première
œuvre majeure pour orchestre seul du musicien alors âgé de trente-deux
ans, dix ans après l'Ouverture de Shéhérazade.
Ravel a subi une
influence hispanique de par sa mère, d'origine
basque, qui lui chantait
souvent des mélodies de son pays. Cette inspiration se retrouve dans
toute la période créatrice du musicien (Pavane pour une infante
défunte, L'Heure espagnole, Boléro, etc.). On note que
sa Rapsodie espagnole fut écrite un an avant Iberia de
Claude Debussy.
Une première version
pour deux pianos fut composée durant l'été 1907, suivie rapidement d'une
transcription pour orchestre. La création eut lieu le 5 mars 1908 au
Théâtre du Châtelet par l'orchestre des Concerts Colonne sous la
direction d'Édouard Colonne, avec un succès très mitigé. L'œuvre fut
cependant appréciée par Manuel de Falla.
Elle comporte quatre
parties et son exécution dure environ un quart d'heure. La seconde
partie est une danse, proche du fandango, issue du folklore de Malaga.
La Habanera est une reprise orchestrale d'une pièce pour deux
pianos composée en 1895 et qui appartenait aux Sites auriculaires
: Prélude
à la nuit :
très modéré -
Malagueña :
assez vif - Habanera assez lent et d'un rythme las -
Feria :
assez animé |
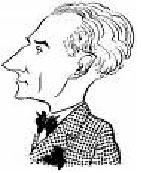 |
|
retour début de page
|